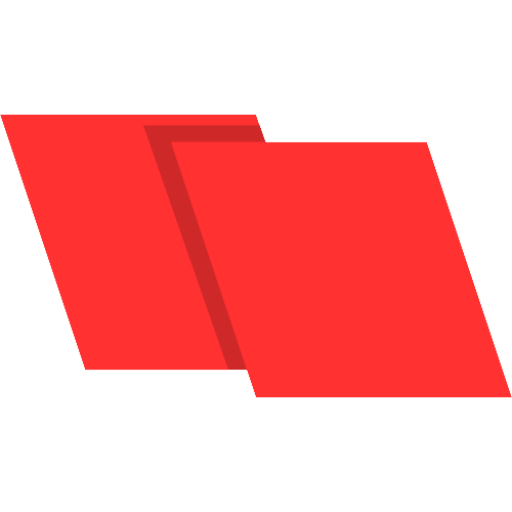Auteur/autrice : Pigeon Rouge
-
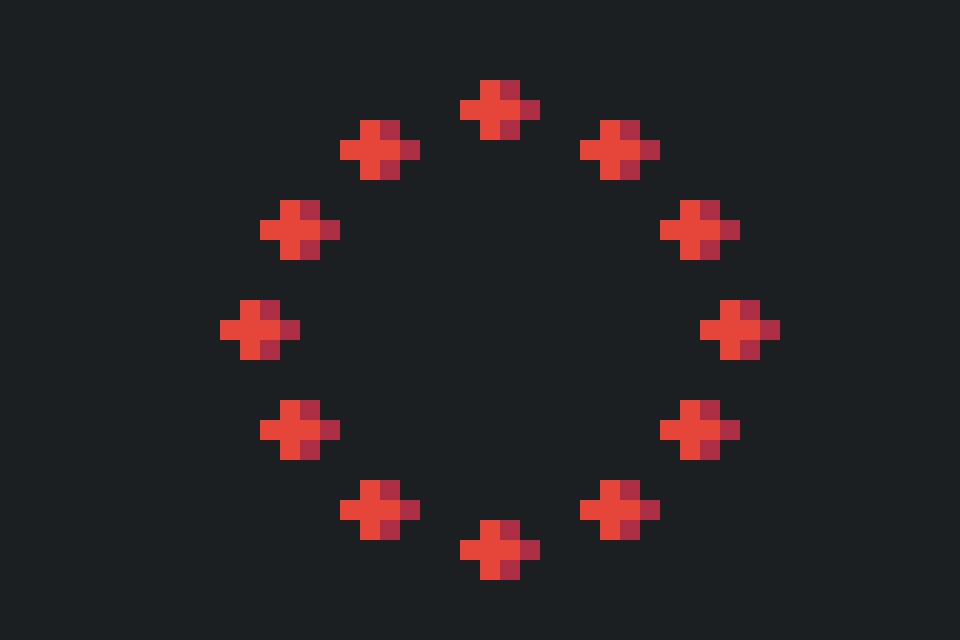
Une liste européenne de « pays sûrs », quand la rapidité prime sur l’humanité
Ce mercredi 16 avril 2025, la Commission européenne proposait la création d’une liste de pays dits sûrs pour « simplifier et accélérer la procédure de vérification du statut de réfugié » des demandeurs d’asile.
Cette liste, proposée avec sept pays pour commencer (le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l’Egypte, l’Inde, le Maroc et la Tunisie) cherche à accélérer la procédure de demande d’asile pour désengorger les juridictions en rejetant plus rapidement les demandes provenant de pays avec moins de 20% de reconnaissance d’un droit d’asile. Cette proposition vient complémenter le Pacte sur la Migration et l’Asile, adopté le 10 avril 2024 et prenant plein effet en 2026. Dans le même esprit que ce texte, la nouvelle proposition cherche à faciliter les refus d’asile en fonction du pays d’origine et selon une liste commune à l’union, plutôt que de laisser les états membres décider par eux-mêmes, comme c’est actuellement le cas en France avec notre propre liste nationale de « pays sûrs », établie le 9 octobre 2015.
Le droit des personnes à bénéficier d’une protection internationale face à une oppression subie dans son pays d’origine est un droit fondamental reconnu par la Convention de Genève de 1951. L’article premier, en son deuxième alinéa, définit le réfugié comme toute personne « qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
Le statut de réfugié est donc particulièrement personnel, en ce que, dépendant du contexte et de la personne, des faits peuvent justifier le besoin de protection d’une personne fuyant son pays. Ce caractère individualiste est absolument primordial, en ce qu’il permet une appréciation au cas par cas de la situation de chacun et la prise de mesures appropriées pour assurer une protection adéquate à chaque personne la demandant. La définition vague du statut de réfugié permet donc son adaptabilité à travers les années et à l’actualité internationale.
Les listes de « pays sûrs » ont toujours été critiquées par les associations de protection des droits humains et à bonne raison, puisqu’elles imposent une généralisation sur le pays d’origine pour influencer la reconnaissance ou le manque de celle-ci du statut de réfugié. Par soucis de rapidité, ces énumérations effacent l’individualité d’une demande, fragilisant l’accès au statut protégé.
Si elle est adoptée par le Parlement européen, cette liste imposerait un cadre à l’échelle de l’union pour rejeter des demandeurs d’asile au simple motif que leur pays est considéré suffisamment sûr. Et, bien que la proposition mentionne le besoin de traiter individuellement les affaires de ressortissants des pays sur la liste, il est certain qu’elle marque une étape vers une généralisation de la procédure de vérification du droit d’asile.
Intéressons-nous aux pays proposés pour initialiser la liste :
Le Bangladesh, qui a obtenu son indépendence du Pakistan après un génocide ayant laissé le pays fragilisé, figure parmis les derniers dans les classements en terme de liberté de la presse, de sécurité et de liberté d’expression. Le 14 août 2024, Amnesty International lançait un appel au gouvernement Bangladais pour protéger les minorités religieuses, dont les maisons, commerces et lieux de cultes sont régulièrement attaqués.
Au Kosovo, la presse est régulièrement attaquée, et de nombreuses discriminations sexistes, xénophobes et anti-LGBT persistent à cause de l’inaction du gouvernement. RSF déplore, dans son dossier sur le pays, une discrimination linguistique des minorités serbes et de leurs médias, ainsi qu’une pratique d’intimidation par des procédures-bâillons et une discrimination administrative des médias d’investigation privés.
En Colombie, la situation sécuritaire est désastreuse, Médecins Sans Frontières y déplore des communautés isolées de « dizaines de milliers de personnes prises au piège de la violence » . L’accès à la santé, et particulièrement à l’avortement est faible selon Amnesty International. Les peuples autochtones sont régulièrement visés et les autorités recourent excessivement à la violence. RSF alerte en particulier sur la violence rencontrée par les journalistes enquêtant sur l’exploitation minière et la déforestation dans le pays.
En Egypte, Amnesty International dresse un portrait alarmant, déplorant la répression de l’opposition politique, l’arrestation d’opposants et de journalistes, ainsi que des disparitions forcées et tortures infligées aux dissidents politiques par les forces de sécurité, ainsi que l’application de la peine de mort suite à des procès inéquitables sous prétexte de terrorisme avec l’aide d’aveux forcés sous la torture et de preuves fabriquées. RSF compte à ce jour 20 journalistes détenus à tort par les autorités, et une absence de pluralisme médiatique à cause d’une censure institutionnelle ne permettant l’expression que des appareils d’état.
L’Inde détient à ce jour 3 journalistes emprisonnés à tort et a provoqué la mort d’un autre depuis le 1er janvier 2025. RSF y déplore une censure stricte des médias permettant au président indien, Narendra Modi de conserver le pouvoir depuis 2014. Le nationalisme indou du parti politique au pouvoir, le BJP, mène à des discriminations sexistes et religieuses dans le pays, les musulmans étant particulièrement persécutés. Les destructions de biens, habitations et lieux de cultes de la population musulmane est commune et les expulsions forcées sont régulières, selon Amnesty International, qui déplore de fortes discriminations sociales fondées sur les castes. La situation environnementale est également désastreuse, les déchets chimiques d’usines textiles et d’emballage empoisonnant les sources d’eau des villages dans un pays où l’accès à la nourriture est limité.
Au Maroc, la liberté d’expression, particulièrement politique, n’est pas assurée, Amnesty International constatant l’emprisonnement d’au moins six personnes, dont des militants et un journaliste, pour avoir exprimé des opinions contraires au régime. Les opposants politiques dans le Sahara occidental sont également régulièrement visés. Malgré des avancées en terme de libertés sociales et une amélioration de la situation sécuritaire, RSF déplore une forte propagande gouvernementale orchestrée à l’aide de campagnes de désinformation et des pressions exercées contre les journalistes indépendants. Le sexisme y est un problème récurrent, les tabloids nationaux, très lus, y participant activement.
Enfin, la Tunisie connait une importante répression de l’opposition politique au régime en place, selon Amnesty International. La liberté d’expression n’est pas assurée, les juridictions prononçant régulièrement des condamnations contre des journalistes pour leurs opinions contre le régime. La justice est mise aux ordres du pouvoir, les juges ne s’y pliant pas se retrouvant exclus de leurs juridictions. La liberté de réunion et d’association est mise à mal, tandis que les droits des femmes restent très faibles. Les droits LGBT sont mis à mal, des campagnes de harcèlement sont tolérées par le pouvoir en place, qui ferme les associations d’aide aux personnes queer. La justice, elle, continue de prononcer des peines de prison contre les personnes homosexuelles.
Vous l’aurez compris, ces pays sont loins d’être aussi sûrs que la proposition de la Commission européenne ne le laisserait imaginer. L’intégralité de cette liste présente des pays où des discriminations sexistes, anti-LGBT et souvent contre la liberté d’expression sont monnaie courante. Devant le simple exposé de la répression et des discriminations exercées dans ces sept pays, on peut tout à fait comprendre la volonté de certains à craindre un retour dans leur pays d’origine.
Il existe alors un réel risque, si cette proposition venait à être adoptée, pour les demandeurs d’asile ressortissants de ces pays, en ce que les juridictions nationales de chaque état membre pourrait, dès lors, expédier le refus des demandes en prétextant de l’apparente sécurité des pays d’origine, une sécurité tenant purement de la statistique et ignorant les réalités politiques et sociales de ces pays.
La Commission semble alors prioriser le traitement des dossiers de demandes d’asile à une étude sérieuse des risques rencontrés par les demandeurs d’asile.